Jusqu'au début du XVIIIe siècle, la mer et ses côtes sont considérées comme dangereuses avant de devenir lieux de promenades et de plaisir. Les inventeurs de la villégiature sont sans conteste les anglais, qui dès le milieu du XVIIIe siècle vantent les vertus des bains de mer.
C'est à la fin de la restauration qu'une architecture de la villégiature se développa sur notre littoral autour de la fonction thérapeutique et curative à l'image de la ville de Dieppe, en écho aux villes d'outre-manche, Brighton, Hastings, Yarmouth.
Avec la révolution industrielle, la modernisation de la navigation à vapeur et l'arrivée du chemin de fer, la Côte fleurie se transforme et se développe progressivement. L'ouverture des premières lignes de chemin de fer va entraîner un engouement de la bourgeoisie parisienne pour le littoral. Dès lors la fonction curative va se marginaliser pour une pratique plus mondaine du séjour sur la côte normande - voir et être vu - au profit ensuite d'activités ludiques ou sportives.
Photos : E.G Copyright 2020

Ce phénomène balnéaire entraine une mutation progressive de la physionomie du littoral.
Les sociétés de transports, les industriels, les promoteurs, les banques s'allient pour conquérir et privatiser des parcelles publiques du littoral. Ces espaces sont souvent inconstructibles voir insalubres. Après drainage et viabilisation des terrains, débute la création de villes nouvelles conçues ex nihilo (Cabourg, Deauville) et la transformation d'autres (Trouville-sur-Mer, Villers-sur-mer, Houlgate - anciennement Beuzeval).
En 1903, le nom évocateur de "La Côte fleurie" sera donné à cette partie du littoral comprise entre Cabourg et Trouville-sur-mer. A ce jour, elle conserve un grand nombre d'édifices architecturaux sans égal qui constituent à n'en pas douter les véritables monuments et attractions de la côte.
Je vous propose donc d'en découvrir quelques-uns en parcourant ces villes qui ont marqué l'âge d'or de cette tendance architecturale entre 1850 et 1930.
CABOURG
Dès 1853, sous l'impulsion de l’homme d’affaires Henri Durand-Morimbeau, Cabourg jusqu'alors petit village de pêcheurs se transforme en ville nouvelle, d'abord lentement puis avec l'arrivée de la ligne de chemin de fer depuis Paris en 1854, les constructions s'accélèrent et les architectes font parler leur créativité et fantaisie.

En 1862, le Grand Hôtel est construit et 6 ans plus tard un nouveau casino en pierre remplace l'initial construit en bois.
Les nouvelles villas s'articulent autour du Casino et du Grand Hôtel dans des rues en arc de cercle, formant ainsi une sorte de toile d'araignée ou d’amphithéâtre; plan urbain conçu par l'architecte caennais Paul Leroux.
Environ 200 villas vont être construites entre 1856 et 1881, pas moins de 400 nouveaux édifices vont voir le jour entre 1881 et 1899.
Les formes architecturales européennes des siècles passés vont être reprises mais avec des compositions plus pittoresques.
Les tours et toitures complexes font leur apparition, l'usage de matériaux est plus varié (silex, bois, pierre, céramique) et les décors plus denses. Ces évolutions donnent de la fantaisie en adéquation avec la création d'un lieu qui va servir de cadre à la mondanité, aux plaisirs et à la fête.
Le Grand Hôtel

Nous sommes au coeur de la station avec le Grand Hôtel et le Casino vers lesquels convergent les rues parsemées de villas au style éclectique, mélange de couleurs et de matières.
Le Grand Hôtel fut reconstruit en 1907 sous le contrôle des architectes Lucien Viraut et Émile Mauclerc, lui donnant une nouvelle dimension architecturale. Les façades sont ornées de motifs stuqués de style "Beaux-arts" du début du 20ème siècle.
Il doit sa célébrité à la fréquentation de Marcel Proust entre 1907 et 1914 (chambre 414). La promenade qui longe l'hôtel et la plage portent son nom, le restaurant gastronomique du Grand Hôtel porte celui de Le Balbec, nom imaginaire donné à Cabourg dans "À la recherche du temps perdu".
Dès lors, les destins de la ville et de l'écrivain vont être étroitement liés. Cabourg va devenir la station romantique réputée de la Belle-époque.
Villa L'argentine

Parfait exemple de style éclectique, mélange de couleurs, de matières et de styles (moellon de silex, mosaïque et briques).
Elle est située dans le secteur des Jardins du Casino, comme nombre de villas remarquables.
Villas La Goélette, La Frégate et la Corvette

Ces 3 réalisations de style flamand présentent chacune des pignons différents. La Goélette est dotée d'un pignon à galbe simple, la Frégate un pignon à volute et la Corvette un pignon à redents.
Villa La Normandine

Belvédère avec vue sur mer. Propriété du maire de l'époque Auguste Joseph Pégat.
D'autres villas cabourgeaises
Du village de Beuzeval à la station d'Houlgate
Au Début du XIXème siècle, Houlgate se nomme Beuzeval et, à l'image de Cabourg, n'est qu'un village d'agriculteurs doté d'un petit bourg de pêcheurs en bordure de fleuve. Puis progressivement le village va se transformer en villégiature de mer avec l'arrivée de la première clientèle caennaise.
Le véritable développement balnéaire va se produire en milieux de siècle (1858-1860), avec l'arrivée d'investisseurs qui ont l'ambition de développer la rive droite du fleuve comme pour la ville nouvelle de Cabourg sur la base d'un plan d'urbanisation.
Un grand hôtel est construit en 1859. La station balnéaire naissante supplante celle de Beuzeval-les-Bains. Le nom de la commune est tout d'abord changé en Beuzeval-Houlgate pour prendre définitivement le nom d'Houlgate en 1905.
Le Grand Hôtel

Un des édifices les plus remarquables de la Côte fleurie. Le corps central du bâtiment (1859) est porté par des pilastres d'ordre colossal en brique. Il possède un étage en attique avec balcon en ferronnerie.
Il est encadré par deux pavillons richement décorés (1896-1897). Une rotonde surplombée d'un dôme vient compléter l'ensemble (1904).
Villas Les Sirènes et Les Courlis

Villas jumelles de composition symétrique visibles uniquement sur la façade sud, jumelées coté nord-ouest.
Les Villas américaines


Au nombre de 5, ces villas locatives (1883), dite Villas américaines, furent commanditées par le banquier américain John Harjès et constituaient à l'époque le seul ensemble concerté d'Houlgate. Ici, voici Juniata, Minnehaha et Tacoma (manque Columbia et Merrimac), noms présents sur chacun des cartouches émaillés, en référence à des lieux du pays d'origine de John Harjès.
Le Sporting Club

Au début du XXème siècle, Houlgate est devenue une ville de plaisirs et d’activités futiles. Les activités sportives se développent et se concentrent sur la plage et le Sporting club, construit en 1906.
Villa Les Haies

Bâtie en 1890 pour le compte du maire de l'époque Albert Février. Eclectisme architectural total dans cette réalisation - Tour d'angle régionaliste normand, pavillon style Louis XIII, pignon à l'esprit flamand, multitude de matériaux et décors sculptés.
Villa Les Clochettes


Réalisée en 1889, c'est la richesse de son décor qui attire, polychromie ou vernissage des briques, mosaïque sous toiture et bancs de clochettes sur corniche.
D'autres villas houlgataises...
Benerville-sur-Mer
En quittant Houlgate pour Deauville, nous traversons Villers-sur-mer, Blonville-sur-mer, Benerville-sur-mer et prenons la direction de Deauville. Les belles villas sont également nombreuses et plus particulièrement en bordure de côte à Benerville-sur-mer.
Prolongement de la ville de Deauville, tel un faubourg, les villas de Benerville encore présentes, sont les témoins d'une villégiature mondaine de la belle époque et font parties du patrimoine architectural de la commune. Elles ont accueilli durant la période estivale hommes du monde, artistes et écrivains reconnus (Boudin, Renoir, Proust, Claudel, Gallimard...)
Villa Rosina ou Villa Victoria

La Villa Rosina est une villa anglo-normande qui surplombe la plage sur les flancs du mont Canisy. Elle a été construite dans les années 1870 par l'architecte Marcel Madeline. Elle fût la résidence d'été de Jean Schlumberger, écrivain et fondateur avec Gaston Gallimard de La Nouvelle Revue Française (NRF).
Villa La Roche Fendue

Construite pour le compte de Gustave Nicolas Joseph Rabiet, négociant en vins parisiens. Cette large bâtisse voisine de la Villa Rosina surplombe comme elle la plage de Benerville. A l'origine un imposant escalier desservait la plage depuis la terrasse de la villa.
Parmi ses propriétaires, il y a Georges Schwob d'Héricourt connu dans l'industrie textile française. Il est représentant de la Compagnie générale pour l'industrie comme commissaire de la Société d'électricité et d'automobile Mors - voir La Villa Mors à Tourgéville.
Tourgéville
Hormis quelques manoirs situés dans les terres, cette commune dispose de peu de villas remarquables en front de mer. Il en existe deux qui doivent retenir notre interêt, la Villa Ivy et la Villa Mors.
Villa Ivy

Belle villa à toitures et ouvertures multiples
Villa Mors

On ne peut passer sous silence cette villa de nos jours abandonnée - la Villa Mors ou La Tour carrée - de style néo-gothique.
Elle a été commanditée par les frères Mors, et construite en 1905.
Louis et Emile Mors sont alors des pionniers dans la conception et la course automobile. En 1907, un certain André Citroën devient le directeur général de leur société avant de la racheter au lendemain de la Grande Guerre.
Voici avec l'histoire de ces deux frères et de leur Villa Mors, une parfaite illustration de l'âge d'or de l'architecture balnéaire au début du siècle dernier. Louis Mors, a fait fortune dans le matériel électrique et la signalisation ferroviaire, il est un amateur de théâtre, mécène, critique d'art, passionné de musique. Il crée une chaire de musicologie au Collège de France, rachète des parcelles dans l'actuel quartier du Ranelagh à Paris, pour y construire un vaste hôtel particulier et par la suite un salon de musique où une activité musicale se développera de 1900 jusqu'à sa mort en 1917.
Cette folie des grandeurs s'étendra donc jusque sur la Côte fleurie avec la construction de son imposante et démesurée Villa Mors.
Villa L'Alcyon

Austérité bourgeoise pour cette villa
Deauville
La naissance de Deauville doit son origine au désir d'un seul homme, le Duc de Morny, séduit par la beauté de la côte normande proche de Paris, après un voyage à la fin des années 1850.
Associé au Docteur Olliffe son médecin personnel et au banquier Armand Donon, le Duc de Morny projette de créer une station balnéaire pour attirer l’aristocratie parisienne, française mais aussi étrangère, et faire du lieu la rencontre de l'élégance, du plaisir et du loisir.
Tout comme à Houlgate, des parcelles insalubres constituées de zones marécageuses sont achetées au domaine public en 1859 puis drainées. Le plan de la ville est réalisé par l'architecte Breney. Les premières villas de style Second Empire commencent à sortir de terre, exemple pour l'époque de l'élégance aristocratique à la mode deauvillaise, mais elles sont principalement en brique pour résister à l'air marin et non plus en pierre.
Puis tout va très vite ensuite.
La ligne de chemin de fer Paris - Lisieux est prolongée par décret impérial jusqu'à Deauville, la gare est construite dès 1863. Suivront hôtels, casino et champ de courses en 1864.
Le Duc de Morny commandite sa propre villa pour attirer les autres mondains à faire de même.
La réussite est totale, en moins de 10 ans, on dénombre déjà une quarantaine de villas qui à l'époque donnent directement sur le front de mer.
Villa Le Cercle

Fondé en 1873 à l'initiative d'un groupe de propriétaires et sportifs désireux de retrouver en villégiature leurs habitudes dans les cercles parisiens, le Cercle de Deauville avait comme membres des hauts dignitaires de l'aristocratie et de grands propriétaires d'écuries de courses.
En 1876, ce bâtiment est construit sous la direction de l'architecte Breney. Il s'inspire du style Tudor de l'architecture anglaise. A noter, l'élégante bichromie de la brique et les baies rectangulaires avec leur fronton orné d'un buste de femme en terre cuite.

Villa Mireille
Villa fin 19ème, début 20ème, mélange de styles éclectique, néo-médiéval et anglais.
Le plan est singulier avec son implantation en angle d'îlot.

Villa Sweet Cottage
Construite vers 1875 pour le compte du Marquis de Salamanca.
Mélange de styles; pittoresque, italien (toits à long pans brisés), anglais (bow-windows et portique) et normand (faux pans de bois, toits à long pans, auvent en façade).

Villa La Dauphinière
Anciennement Villa des Ours
Elle fait partie des premières constructions de la station balnéaire de Deauville. Propriété de Paul-André Demètre, ancien secrétaire du Duc de Morny, en 1868.

Villa Saint-Clair
Edifiée entre 1866 et 1873, elle est l'une des rares villas du Second Empire encore en place à Deauville.
Villa en angle d'îlot, style néo-médiéval, tourelle d'angle polygonale, historiciste.

Villa Green Lodge
Construite entre 1908 et 1910.
Cette villa de style normand et art nouveau constitue avec ses communs, un ensemble homogène peu remanié.

Villa Roxelane
Anciennement Villa Perla
La villa combine des références à l'architecture locale traditionnelle (pan de bois, tuile plate) et savante du 17e siècle (toit en pavillon autrefois rehaussé d'une crête de toit et d'épis de faîtage en zinc).

Villa Le Hoc
Anciennement Caisse de Trouville-Deauville
Créée en 1863 par les fondateurs de la station, la Caisse de Trouville-Deauville est une banque de dépôt, d'escompte et de recouvrement dont dépendent les différentes sociétés immobilières sur lesquelles reposent la création et de le développement de la station.
En 1893, la Caisse est dissoute.
En 1898 Désiré Le Hoc, maire de Deauville, acquiert l'immeuble et l'occupe jusqu'à sa mort en 1919.
Cette construction a fortement été remaniée et amputée.

Villa Les Ajoncs
En 1884, Eugène Boudin fait construire à Deauville, cette villa - aujourd’hui rebaptisée La Breloque - où il passera les quatorze dernières années de sa vie.
C’est dans cette maison qu’il meurt le 8 août 1898.

Villa L'Albatros
Construite en 1875 pour le compte Monsieur Lemaître, elle est passée depuis entre plusieurs mains et appartient depuis 1974 à l'ambassade de Russie.

Villa Camélia
Bâtie en 1865 par l'architecte Breney pour le Marquis de Salamanca.
Cette villa en briques polychromes avec des pignons inspirés de l'architecture d'Europe du Nord est l’une des plus anciennes et des plus singulières villas de Deauville. A noter le décor en bois rapporté qui évoque les isbas russes.

Villa Griselidis
Construite en 1871 pour le banquier Jules Tenré, en brique polychrome.
Parfaite illustration du courant éclectique en cours au second Empire avec ce style d'inspiration flamande de la Renaissance avec ses pignons à redents.

Villa Les Abeilles
Construite entre 1910 et 1912 par l'architecte Auguste Bluysen, pour le compte de la couturière Irène Paquin, croisement entre le style régionaliste normand et l'art nouveau.
Elle fut ensuite la propriété d'André Citroën.
Mais Deauville subira un coup d'arrêt avec la chute de l'Empire et la crise économique de 1870. Le trafic marchand se réduit au profit du Havre. Une crise écologique viendra amplifier le phénomène. La plage de Deauville créée artificiellement ne résiste pas aux tempêtes de 1875, il se créé alors une noue entre la plage et la terrasse qui deviendra progressivement un lais de mer.
La mer ne devient accessible qu'avec la construction de jetées pour l'atteindre.
L'aristocratie déjà fragilisée par la chute de l'Empire déserte alors ses villas
Il faudra attendre les années 1910 avec l'action du maire Désiré Le Hoc pour voir la ville redevenir attrayante. Mais l'épopée des villas est quant à elle belle et bien terminée, souvent ouvertes pour la belle saison elles sont difficiles à entretenir. Elles vont désormais être délaissées par la bourgeoisie aisée en villégiature qui lui préfère les hôtels plus confortables du Normandy et du Royal.
Hôtel Le Normandy

Le Normandy est construit au cours de l'hiver 1911-1912 sous la direction des architectes Théo Petit et Georges Wybo. Il est inauguré en été 1912. Il sera par la suite agrandi.
Situé en front de mer côté nord-ouest, il est d'aspect monumental et régionaliste. La structure est en béton armé masquée par un enduit et d'un parement en damier. Les parties hautes sont ornées d'un faux pan de bois dans l’esprit des constructions vernaculaires du pays d'auge de la fin du 18ème siècle. A noter les nombreux décrochements en façade et la multitude d'éléments saillants pour beaucoup empruntés à l'architecture du Moyen-âge.
Le toit est orné d'épis de faîtage en céramique d'inspiration animale.
Hôtel Le Royal

L'ouverture du Normandy hôtel est un franc succès dès la première année. Eugène Cornuché souhaite doter la ville d'un second palace, avec les mêmes acteurs que celui du Normandy, les architectes Théo Petit et Georges Wybo.
Inauguré en 1913, il subit de suite les critiques les plus féroces quant à son architecture. Un monument massif, un mastodonte, une caserne, comparé à l'élégance de son voisin. Une conception moderne du style normand pour l'époque mal acceptée.
La façade principale côté mer comporte 21 travées avec des corps en saillie, le tout couronné par un toit à l'impériale. il possède d'immenses baies vitrées sous une galerie portée par des colonnes ioniques.
D'autres villas deauvillaises...
On recense de nos jours plus de 300 villas mais désormais le style normand à pan de bois de l'architecte Emile Mauclerc - voir Cabourg - devient globalement le style architecturale de la station.
Trouville
Trouville est en avance sur ses autres concurrentes.
La station connait ses premières fréquentations mondaines dès l'ouverture d'un salon de bains en 1838 et d'un théâtre 5 années plus tard. Cet édifice en bois abrite plusieurs salles vouées aux distractions - bibliothèque, salon de jeux, salle de bals et de concerts, salon de conversation. En résumé ce théâtre peut être considéré comme le premier casino sur la côte normande.
Dès 1842, la station se développe à l'image de Brighton, outre manche.
Un premier établissement de bains municipal voit le jour, des cabines fixes de plage, des tentes, un chemin de planches viennent compléter le front de mer trouvillais.
Les grands hôtels suivent l'année suivante, prêts à offrir les prestations de luxe qu'attendent une clientèle fortunée. D'autres aristocrates du Second Empire commanditeront la construction de leur maison de villégiature auprès d'architectes parisiens, pas moins de 30 maisons vont être construites entre 1840 et 1850.
L'essor de la station tient également à une caractéristique propre à elle-même et copiée ensuite par sa voisine - Deauville - sa double vocation balnéaire et portuaire. Tous les aménagements opérés pour faciliter le développement de la marine marchande à Trouville vont également profiter à la station balnéaire. Le trafic de voyageurs est grandement facilité par les liaisons vapeurs avec la ville du Havre déjà desservie par le chemin de fer (Paris - Le Havre 1847).
Les Roches Noires

Construit en 1866 par l'architecte Alphonse-Nicolas Crépinet.
Cet hôtel avec une architecture de masse grandiose est encadré de deux ailes parallèles. Doté d'une façade de briques entablées dans la pierre et de larges fenêtres et balcons s'ouvrant sur la mer. Il sera transformé en partie en 1924 par l'architecte Mallet-Stevens et sera définitivement distribué en appartement en 1950.
L'hôtel offrait à sa riche clientèle un confort et un luxe jusqu'alors inégalé sur la côte normande. Une clientèle à dominante anglaise, américaine et russe, rendue possible grâce à l'existence d'une digue-promenade qui avançait jusqu'à 600 mètres en pleine mer et permettait ainsi l'accostage des bateaux vapeur en provenance du Havre.
Doté de plus de 300 chambres (1913) et appartements privés éclairés à l'électricité (1904) et de cabines de bain sur roues alimentées en eau par traction animale, il devient le principal concurrent des hôtels de Deauville.
Marcel Proust fréquenta l'hôtel entre 1890 et 1915 et y séjourna durablement plusieurs fois dans l'appartement n°110.
L'écrivain laissera aussi une trace de son passage dans de nombreuses villas trouvillaises proches des Roches Noires, que ce soit en front de mer ou sur les hauteurs de Trouville.
Le Clos des Muriers

De style normand, cette villa a été construite selon les plans de l'architecte A. Le Ramey entre 1894 et 1896. Sa commanditaire est Madame Geneviève Halévy, épouse Straus, veuve de Georges Bizet. Elle fut l'égérie de son ami d'enfance Marcel Proust - un des modèles de la Duchesse de Guermantes dans "À la recherche du temps perdu".
Durant cette période, le Clos des Muriers verra passer toute "la société parisienne" de l'époque - écrivains, journaliste, critiques, éditeurs et hommes de spectacles, la géographie du monde littéraire et des spectacles oscille entre Paris et la côte normande.

La Cour Brulée
Bâtie en 1864 et commanditée par Lydie Aubernon de Neville, inspiratrice de Marcel Proust pour son personnage de Madame Verdurin.
La Villa Persane

Construite en 1859 et devenue en 1876 propriété de Hélie de Talleyrand-Périgord, Prince de Sagan. Sa femme la Princesse de Sagan, servira de modèle à Madame de Luxembourg dans "À la recherche du temps perdu".

Musée Villa Montebello
Architecte Jean-Louis Celinski (1866)
Construite pour le compte de la Marquise de Montebello, avec un style très caractéristique de l'architecture balnéaire du Second Empire.
Devenue depuis 1972, musée municipal de la ville.

Villa Sidonia
Commanditée par le banquier Alfred Honoré et construite en 1868 selon les plans de l'architecte Désiré Devrez.

Villa des Flots
Construite selon les plans de l'architecte E. Delaistre (1875).
Elle est située en extrémité de plage, et accueillit régulièrement la famille Eiffel.
La Tour Malakoff

Commanditée par le peintre Charles Mozin et édifiée en 1855, cette villa d'inspiration médiévale est dressée face à la mer.
Le Casino et les Cures marines
Le casino a été construit selon les plans de l'architecte Alexandre Durville (1912).
Il se singularise des constructions de casinos précédentes, car il rassemble en un seul bâtiment tous les usages du moment (mondain, ludique et curatif).
D'autres villas trouvillaises...
Inventée en Angleterre au début du XVIIIe siècle, la station balnéaire va se diffuser progressivement puis très rapidement dans le reste de l'Europe et bien sûr en France.
Elle s’inscrit à la fois dans le mouvement de l’avènement des loisirs et de la médicalisation de la société française du XIXe siècle, ainsi que dans le développement des moyens de transport avec accroissement exponentiel du tourisme.
Ce phénomène de développement de la station balnéaire repose une chronologie d'acteurs respectée partout en Europe. Tout commence par les découvreurs suivis par les fondateurs et promoteurs.
Les découvreurs sont avant tout des artistes peintres et écrivains, qui feront les premiers la promotion de la station. Ils sont très vite suppléés par une seconde vague, celle des célébrités, journalistes, directeurs de presses, chroniqueurs mondains, etc. souvent encouragés (voir payés ?) par les promoteurs de stations pour s'offrir leurs services afin d'entretenir et augmenter la notoriété naissante de ces nouvelles villes.
La station balnéaire n'est pas une ville ordinaire et industrielle, mais une ville pleine de pittoresque et d'exotisme. Elle est avant tout un produit commercial destiné à répondre à une demande sociale et culturelle auprès d'une population qui subit la révolution industrielle et cherche à s'échapper des miasmes et maladies de la ville.
Les programmes de création de villes et les programmes d'architecture vont permettre de satisfaire les demandes de villégiature d'une clientèle aisée pour des séjours de plusieurs semaines ou plusieurs mois dans l'année.
Des opérations spéculatives d'appropriation du littoral et de création de stations vont s'enchaîner de Cabourg à Deauville en passant par Houlgate.
A partir du milieux du XIXe siècle, le développement du chemin de fer accélère le phénomène, amplifié à la fin du XIXe siècle par l'arrivée de l'automobile - pour la clientèle aisée - qui concurrence le chemin de fer.
La création de Deauville restera le parfait exemple de ce phénomène spéculatif, avec comme investisseurs parisiens l'alliance du banquier Armand Donon et de l'homme politique, le Duc de Morny qui se trouve être également l’un des principaux actionnaires de la Société des chemins de fer de l’Ouest.
Durant cette période, à chaque station sa fréquentation sociale :
L'aristocratie d'Empire a pour habitude de fréquenter Deauville et Villers-sur-mer pendant que l'aristocratie orléaniste séjourne à Trouville.
Cabourg a les faveurs de la petite bourgeoisie montante et Houlgate celles de la haute bourgeoisie républicaine.
Comment expliquer ces différences de clientèles, sans doute des raisons d'ordre historique, économique et culturel - différences qui semblent avoir influencées et façonnées le style d'architecture dans chacune de ces villes.
La Grande Guerre est le premier coup d'arrêt à ce rythme effréné de constructions.
Après un net rebond dans les années 1920, la crise de 1929 mettra un point final à ce type de villégiatures, les stations sont désertées ici comme sur toutes les côtes françaises. L'âge d'or est passé, et il faudra attendre l'après guerre pour voir revivre ces stations avec l'arrivée du tourisme de masse et avec lui une nouvelle catégorie de villégiateurs.
Rares sont de nos jours les villas en propriété unique. Elles ont majoritairement été démantelées en appartements, ultime solution pour ne pas les voir disparaitre à jamais au profit de programmes immobiliers.















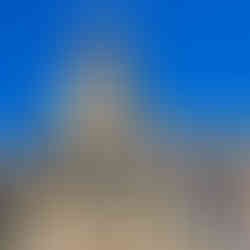

















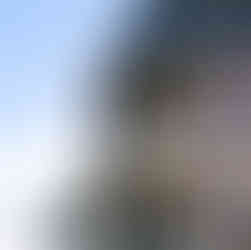



















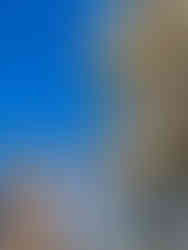

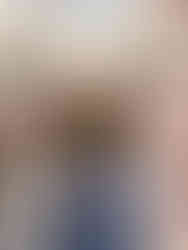



































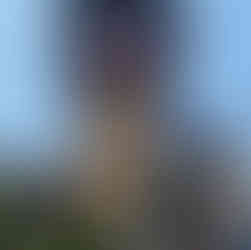

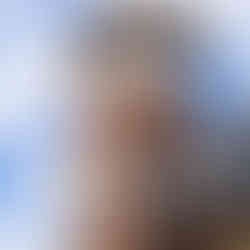

























































































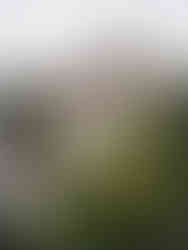







Comments